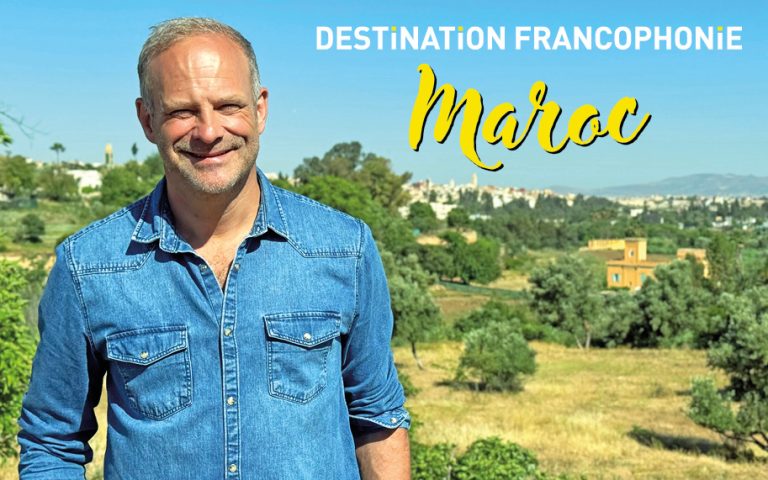Conférence de Daniel Lincot, Directeur de recherche émérite au CNRS au sein de de l’Unité mixte de recherche de l’Institut Photovoltaïque d’Île de France (IPVF), en partenariat avec l’École Centrale de Casablanca.
L’accès à la conversion photovoltaïque directe peut être considéré comme le « game changer » de la relation de l’humanité à l’énergie solaire, comme la photosynthèse le fut il y a plusieurs millions d’années pour la nature. Aujourd’hui les conditions semblent donc réunies pour que l’énergie solaire directe devienne le nouveau pilier énergétique de l’humanité.
L’utilisation de l’énergie solaire alimente depuis les débuts de la révolution industrielle du 19ème siècle les espoirs d’une utilisation à grande échelle pouvant répondre aux enjeux de développement de la société. La puissance de la lumière solaire, illustrée il y plus de deux mille ans par l’épisode des miroirs d’Archimède, a mis des siècles à être démontrée et quantifiée jusqu’aux expériences de De Saussure, Lavoisier ou Buffon au 18ème siècle.
Ce n’est qu’à partir de la moitié du 19ème siècle que son utilisation industrielle est considérée concrètement par Augustin Mouchot dans un livre au titre évocateur « La chaleur solaire et ses applications industrielle » paru en 1869. S’engage alors l’épopée du solaire à concentration et toutes les machines destinées à la cuisson, la synthèse chimique, la distillation, le pompage et l’alimentation de machines à vapeur qui culminera au début du 20ème avant de décliner sous l’effet de la montée en puissance du charbon et du pétrole. Une nouvelle poussée aura lieu dans les années 1970-1980, à la suite du choc pétrolier, qui retombera également ensuite avec les prix bas et l’essor du nucléaire.
En ce début du 21ème siècle on assiste à une nouvelle renaissance du solaire thermique, porté par la crise climatique et le déclin programmé des énergies fossiles, ou le soleil du Sahara fait à nouveau figure d’Eldorado. A cela s’ajoute l’irruption sur la scène énergétique d’un nouveau venu, le solaire photovoltaïque, qui en quelques années a bousculé les schémas établis et s’est imposé comme un candidat incontournable de la transition énergétique. Avec une puissance installée qui vient de franchir le seuil symbolique du terawatt (TW) pour 17 TW correspondants à la puissance consommée par l’humanité, de prévision d’installation de plusieurs centaines de GW par an dans les prochaines décennies, il contribue déjà à la production de 5% de l’électricité mondiale et de 10 à 20% dans certains pays. Son essor est porté, contrairement aux phases précédentes, par la compétitivité économique acquise et croissante ainsi que son universalité d’installation et de ressource incluant, contrairement au solaire thermique de puissance, les zones tempérées mondiales au niveau mondial.
L’accès à la conversion photovoltaïque directe peut être considéré comme le « game changer » de la relation de l’humanité à l’énergie solaire, comme la photosynthèse le fut il y a plusieurs millions d’années pour la nature. Sa découverte remonte à celle de l’électricité au début du 19ème siècle. Nous la devons à Edmond Becquerel en 1939, mais il a fallu attendre la fin du siècle pour voir de premières cellules solaire solides au sélénium et surtout 1954 pour sa vraie naissance industrielle avec la mise au point des cellules au silicium, qui ont permis la conquête spatiale avant l’essor actuel des applications terrestres.
Aujourd’hui les conditions semblent donc réunies pour que l’énergie solaire directe devienne le nouveau pilier énergétique de l’humanité.