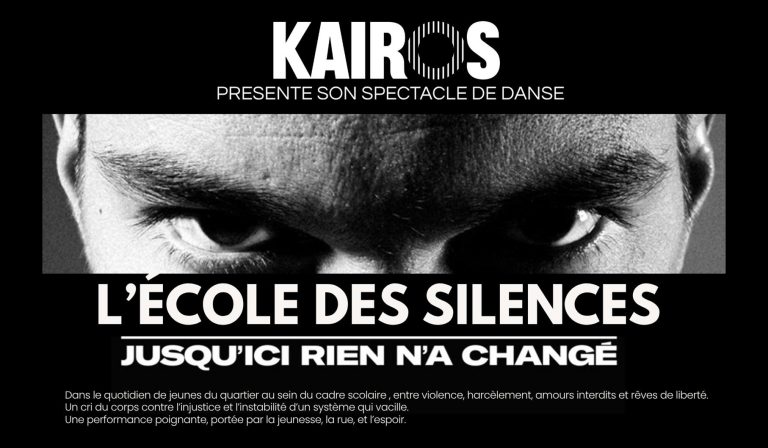Au XVIIe siècle, les ports marocains s’imposent comme des carrefours majeurs de la guerre de course. Grâce à des équipages cosmopolites, les corsaires sillonnent les mers, ramenant captifs et marchandises vers les rivages marocains. Profitant d’une position géographique exceptionnelle au carrefour des routes maritimes, ses marins élargissent progressivement leur champ d’action au-delà des côtes marocaines pour s’aventurer au large l’Atlantique. L’espace maritime compris entre le cap Vert et le cap Finistère, et même au-delà, devient alors leur terrain de chasse favori. Leur activité transforme cette région en un monde redouté, au point que les marins européens évoquent les « Salétins » avec effroi, comme en témoigne une prière du diocèse de Coutances, dans la Manche : « Mon Dieu, gardez-nous des Salétins. »
Les promesses de richesses issues de la course et les perspectives d’ascension sociale attirent des aventuriers venus de divers horizons. Cette activité engendre un véritable mirage autour de la prospérité de villes portuaires marocaines comme Salé et Tétouan, devenues des symboles de fortune, de liberté et de puissance maritime. Mais qui étaient réellement ces corsaires tant redoutés par les marins européens, depuis les Canaries jusqu’en Islande ? Quel impact ont-ils laissé sur la mémoire collective d’ici et d’ailleurs ? Et que révèle précisément cette histoire fascinante ?
Rencontre organisée en collaboration avec l’association Histoire Vivante du Maroc.