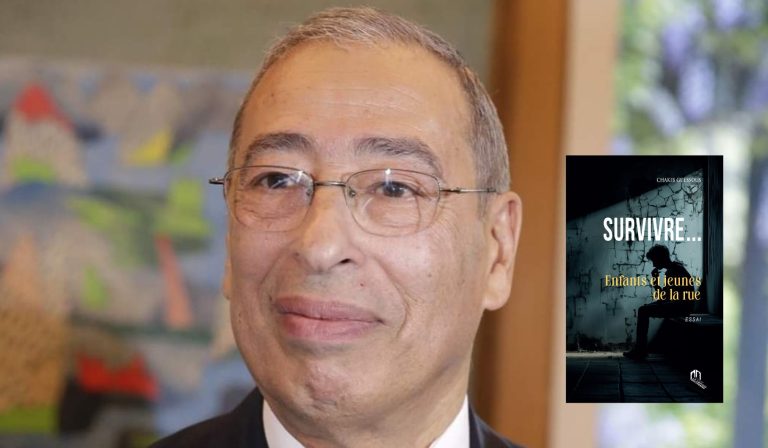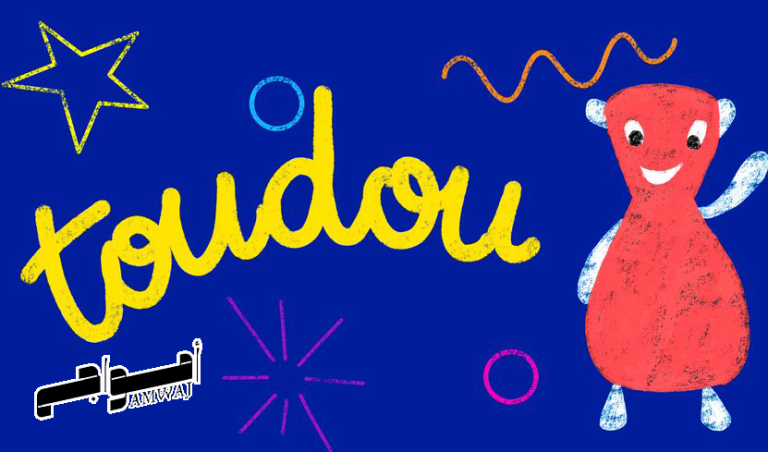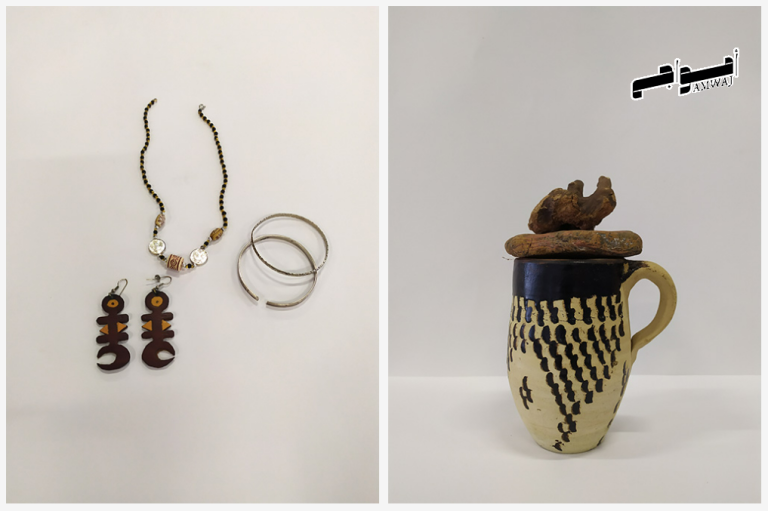Dans une époque où grandit la peur de l’autre et si souvent de la religion de l’autre, cette exposition photographique propose de porter un regard différent sur les interactions interreligieuses autour de la Méditerranée, où s’enchevêtrent les nombreuses branches des trois monothéismes : judaïsme, christianisme et islam.
Sans nier les conflits qui les opposent parfois, l’objectif est de faire (re)connaître le phénomène de la fréquentation des mêmes sanctuaires par des fidèles de religions différentes. Peu connus en Europe occidentale, ces croisements sont pourtant beaucoup plus communs dans les pays dits « orientaux », du Maroc au Moyen-Orient. C’est aussi le cas des Balkans qui ont été durablement marqués par l’empreinte de l’Empire Ottoman dont l’une des caractéristiques était de garantir la liberté de culte aux minorités religieuses.
Fondée sur des années d’enquêtes anthropologiques, cette série photographique fait découvrir au public des lieux sacrés où se déploie une hospitalité de l’« autre religieux » qui devient hôte… à la fois celui qui est reçu mais parfois aussi celui qui reçoit. Ces phénomènes s’inscrivent dans une tradition abrahamique, Abraham/Ibrahim ayant reçu sous sa tente – selon la Bible et le Coran – trois mystérieux visiteurs considérés comme des anges. Bien réelles, ces situations sont toutefois fragiles et sans cesse menacées par l’hostilité de l’autre, qui constitue l’antithèse de l’hospitalité interreligieuse. Ce faisant, le partage devient parfois synonyme de partition et de séparation.
Invitant chacun à faire un pas de côté par rapport à ses propres représentations, l’exposition se présente comme un pèlerinage en images autour d’une Méditerranée circulaire, cheminant d’un lieu saint à l’autre. On y découvre de façon entrelacée des visages d’hommes et de femmes, des rites et des lieux de pèlerinage qui résonnent silencieusement entre eux, parfois à des milliers de kilomètres de distance.
*
En 2017-2018, une exposition sur cette thématique a été présentée à Dar el-Bacha-Musée des Confluences dans la médina de Marrakech. Intitulée Lieux saints partagés, elle était le fruit d’un partenariat entre la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem). L’Institut Français de Marrakech y avait été directement associé et Manoël Pénicaud en était l’un des commissaires. Plus légère, cette nouvelle version se concentre sur un regard photographique d’auteur-anthropologue.
Né en 1978, Manoël Pénicaud est anthropologue et membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne et comparative (Idemec, CNRS, Aix-Marseille Université). Il est aussi photographe, documentariste et commissaire d’expositions.
Ses travaux s’inscrivent dans le champs de recherche de l’anthropologie des pèlerinages, du culte des saints, des relations interreligieuses dans l’espace euro-méditerranéen, du dialogue des religions et plus précisément des questions de l’hospitalité de l’« altérité religieuse.
Son regard photographique s’inscrit dans le sillage de l’exposition Lieux saints partagés dont il est l’un des commissaires et dont différentes versions ont été successivement présentées au Mucem à Marseille (2015), au Musée du Bardo à Tunis (2016), au Musée national de la Photographie à Thessalonique (2017), au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris (2017), à Dar el-Bacha-Musée des Confluences à Marrakech (2017-2018), à la New York Public Library (2018), à Depo à Istanbul (2019), à CerModern à Ankara (2021)…
Ses photographies ont été régulièrement publiées dans la presse : Le Monde des Religions, La Vie, L’Œil, Le Monde de la Bible, Le Courrier de l’Atlas, Télérama, Le Temps, Pèlerin, Qantara, etc.
Parmi ses publications, il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles. Son dernier livre est une biographie : Louis Massignon. Le « catholique musulman » (Bayard, 2020), récompensée par le Prix Lyautey 2021 de l’Académie des Sciences d’Outre-mer et par la Mention spéciale du Prix de L’Œuvre d’Orient 2021.
Citons également les ouvrages collectifs : Shared Sacred Sites, NYPL, New York, 2018 .; Coexistences. Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée, Actes Sud-MNHI, 2017 ; Lieux saints partagés, Actes Sud-Mucem, 2015 (Prix Méditerranéen du livre d’Art). Parmi ses monographies : Le réveil des Sept Dormants. Un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, Cerf, 2016 (2014). et Dans la peau d’un autre, Les Presses de la Renaissance, 2007.
Il a vécu plusieurs années au Maroc entre Essaouira et Marrakech, alors qu’il étudiait les pèlerinages/moussems marocains, notamment le Daour des Regraga et leur culte de sept saints qui est à l’origine de l’appellation de Marrakech comme la ville des Sbatou Rijal… Sur ce sujet, il a réalisé le film documentaire Les Chemins de la Baraka (50min), primé en 2008 au Festival Sol e Luna à Palerme.