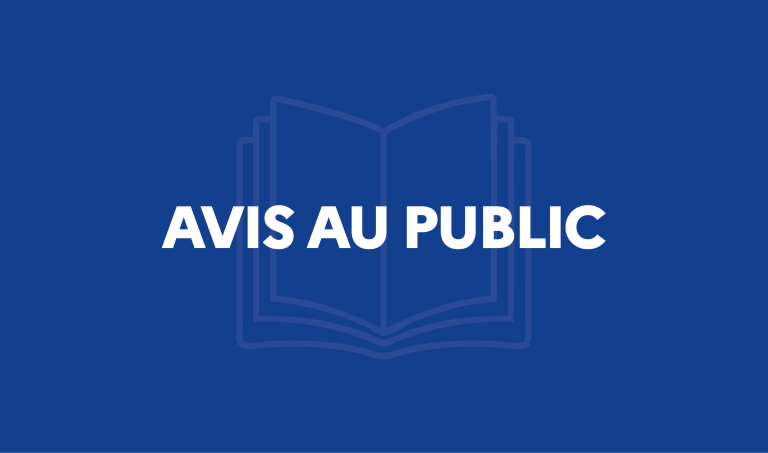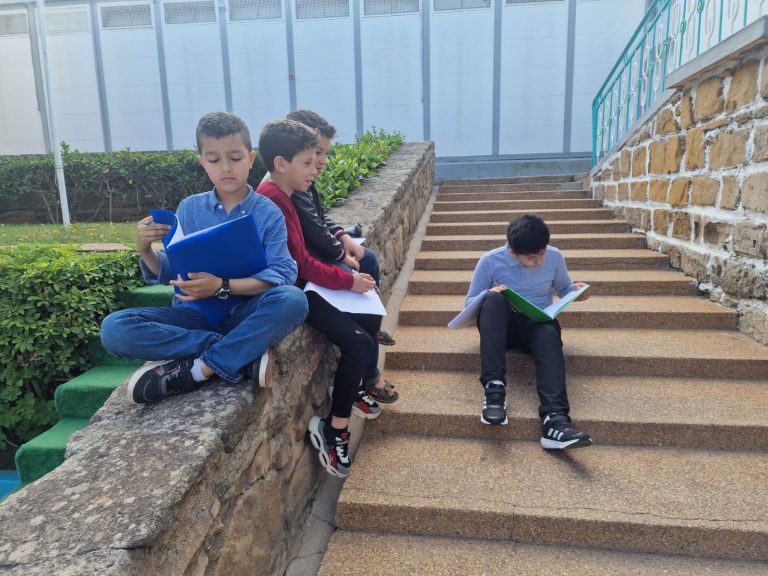Emmanuel Alloa : En finir avec l’universel vertical
Une déclaration comme celle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 peut-elle être universelle, lorsque l’on sait qu’elle a été prononcée par une petite assemblée d’hommes, à l’exclusion des femmes et des étrangers ? Le fait que toute demande d’universalité soit toujours énoncée depuis un lieu et un temps spécifique n’invalide-t-il pas sa portée ? Il devient urgent aujourd’hui d’en finir avec l’illusion entretenue par l’universalisme, celui d’un universel vertical ou de surplomb. Refusant à la fois cet universel de surplomb et une conception du monde comme simple juxtaposition de différences, il s’agit de repenser l’universel. Universel sans universalisme, cet « universel latéral » est celui qui émerge lorsque se croisent nos points de vue inconciliables.
Philosophe, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université de Fribourg, Président de la Société allemande d’esthétique (Deutsche Gesellschaft für Ästhetik). Ses travaux ont été récompensés par plusieurs prix, dont le prix Latsis 2016 et le Wissenschaftspreis Aby Warburg 2019.
Jean-Baptiste Brenet, Camille Riquier et Driss Ksikes : Ibn Rushd (Averroès) en peinture : un refoulement de la pensée arabe ?
Pendant deux cent cinquante ans, entre le XIVe et le XVIe siècle, on a peint en Italie des « Triomphe de saint Thomas d’Aquin » où le théologien chrétien (mort en 1274) apparaît dominant Ibn Rushd (Averroès, mort en 1198) assis ou étendu à ses pieds. Que vient faire sur ces toiles le grand commentateur arabe d’Aristote ? Quel est le sens de cette figuration, a priori négative, qui se répète à travers les âges ?
Il est clair que ces œuvres de propagande travestissent la réalité du rapport complexe d’héritage et de relance que la pensée « européenne » aura entretenu avec la pensée arabe ; mais il se peut qu’elles se trahissent, aussi, laissant voir ce qu’elles entendaient recouvrir. Dedans, et non pas dehors, Averroès, songeur, est un motif inattendu et insistant : le véritable « sujet » de tous ces « Triomphe» ?
Jean-Baptiste Brenet est philosophe, professeur des Universités à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il enseigne la philosophie arabe. Depuis 2021, il a lancé et anime à l’Institut du Monde Arabe (IMA, Paris), les mardis de la philosophie arabe.
Camille Riquier est philosophe, professeur et doyen de la faculté de philosophie à l’Institut Catholique de Paris, membre de la revue Esprit et lauréat de l’Académie française pour son ouvrage Archéologie de Bergson qui a reçu le prix La Bruyère. Il est co-rédacteur des annales bergsoniennes.
Driss Ksikes est écrivain, dramaturge et directeur d’Economia, centre de recherche de HEM, où il encadre des équipes de recherche interdisciplinaires et enseigne la philosophie et les grands débats politiques. Chercheur en médias et culture et auteur associé à plusieurs revues littéraires et critiques internationales, il est à l’initiative de projets mettant l’art, la culture et le débat au cœur de la cité. Il est membre du groupe international de travail sur Arts et Recherches auprès de AFAC (Arab Fund for Arts and culture) et ACSS (Arab Council for Social Sciences) et depuis 2019 membre du comité scientifique du CODESRIA.
Bennacer El Bouazzati (AR) Entre localité et universalité
كل جديد في الفكر والمعرفة ينبت محلّياً. وكل تجديد في الرؤى والتصورات يتبلور في ظروف اجتماعية وثقافية مخصوصة. أيضاً، تنشأ الأعراف والقوانين في ملابسات تاريخية مطبوعة بمميزات ثقافية وإديولُجية خاصّة. وحتى في سياق أدقّ العلوم وأكثرها تجريداً، وعلى رأسها الرياضيات، تبرز المفاهيم ضمن مقام يفعل فيه فاعلون يتبادلون الأمثلة والأدلة والنماذج. وقد تنتشر المنشآت الجديدة في فضاء ثقافي يسمح لها بذلك، وقد تتعرّض لمقاومة؛ والأبنية العلمية مرّت من هذا المسلسل، حيث لا يوجد تجديد علمي لم يشهد مقاومة حتّى من لدن أفراد من الجماعة العلمية بالذات التي ينتمي إليها صاحبُ الفكرة الجديدة. فكيف يصبح تجديد ما مقبولاً كونياً، بينما يظل اقتراح ما حبيس الظرفيات المحلية؟ لا يدّعي صاحب الورقة التيان بجواب شاف؛ لكن نتمنى مناقشة بنّاءة
Philosophe, professeur d’épistémologie et d’histoire des Sciences à la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V. Il est président de l’Association Marocaine de l’Histoire des Idées Scientifiques et Philosophiques.
Abdou Filali El Ansary : Les illusions de la singularité
L’idée est de repenser, à partir de l’œuvre de Ali Abderraziq (auteur de L’islam et les fondements du pouvoir) et de Thomas Bauer (auteur de A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam), le fait que des confusions entre parcours historiques et moments normatifs ont mobilisé énormément d’énergies intellectuelles, sans parvenir à éclaircir les relations entre normes et leurs implémentations dans l’histoire.
Philosophe et écrivain, co-fondateur de Prologues, revue maghrébine du livre destinée au public arabe et francophone, directeur de l’Institut d’études des civilisations islamiques à l’université Agha Khan à Londres.
Elie During : L’impératif extra-terrestre
L’intelligence extra-terrestre n’est pas une question de fait, de conjecture ou de croyance, mais de principe : comme le disait Pascal, « il faut parier ». Et ce quelle que soit la portée qu’on donne au terme « extra-terrestre ». Ce dernier peut désigner aussi bien un petit bonhomme vert que l’entendement divin ou qu’un système d’intelligence artificielle. Et sans parler d’intelligence, l’existence probable d’une vie extraterrestre appelle déjà une généralisation du concept de vie (« lyfe »). La philosophie a-t-elle pris la mesure du décentrement et de la relativisation de l’universel humain qu’implique cette situation ?
Philosophe, maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, directeur de la collection « MétaphysiqueS » aux PUF. Ses recherches portent sur les figures contemporaines de la simultanéité au croisement de la métaphysique, de l’art et de la science.
Natalie Depraz : Que fait la surprise à l’universel ?
Peut-on philosopher sans surprise ? Qu’est-ce qu’une philosophie sans surprise ? J’essaierai de montrer que la surprise oblige les philosophes, si tant qu’elles et ils sont soucieux de s’extraire de son mode dominant, caractérisé par une ontologie de la puissance et une logique du contrôle, lesquelles génèrent prise et emprise. A contrario, une philosophie de la surprise travaillera avec la déprise, avec le lâcher-prise, où s’ouvrent renouvellement de soi et recréation du sens. La question étant : où se situe l’universel sur cette brèche qu’ouvre la surprise ? Du côté de la singularité ? Ou bien de la totalité unifiée ?
Philosophe, professeure à l’université Paris Nanterre. Spécialiste de philosophie allemande et de phénoménologie, elle dialogue avec les champs scientifiques, politiques et littéraires.